Géographie
|
"Les Escartons du Briançonnais". Par Olivier Hanne, agrégé et docteur en Histoire médiévale.
![]() Au
moment où l'histoire des Escartons commence, en 1343, cette contrée
contient 7 200 foyers, soit 30 à 40 000 habitants, répartis sur
une cinquantaine de communautés villageoises autour de Briançon.
Au
moment où l'histoire des Escartons commence, en 1343, cette contrée
contient 7 200 foyers, soit 30 à 40 000 habitants, répartis sur
une cinquantaine de communautés villageoises autour de Briançon.
![]() Dans
ces lieux inhospitaliers, difficilement gouvernables par un pouvoir central,
les municipalités avaient peu à peu pris le pas sur les féodaux.
Les Briançonnais bénéficiaient donc depuis environ 1240,
de très nombreux privilèges et franchises, issus d’un accord
passé alors avec le Dauphin. Dés cette époque les communautés
obtinrent de nombreux droits: gestion de l'eau, gestion des pâturages,
etc...
Dans
ces lieux inhospitaliers, difficilement gouvernables par un pouvoir central,
les municipalités avaient peu à peu pris le pas sur les féodaux.
Les Briançonnais bénéficiaient donc depuis environ 1240,
de très nombreux privilèges et franchises, issus d’un accord
passé alors avec le Dauphin. Dés cette époque les communautés
obtinrent de nombreux droits: gestion de l'eau, gestion des pâturages,
etc...
![]() Tous
les ans, à la Chandeleur (le 2 février), les chefs de famille
du village se réunissaient pour désigner leur "consul".
Celui qui avait le plus de voix était désigné, quelquefois
à son corps défendant. Mais il ne pouvait refuser. Il devait même
déposer une caution de 200 écus, restitués avec intérêt
à son départ, car il était responsable sur ses deniers
du recouvrement de l'impôt et de l'excédent des dépenses
sur le budget prévisionnel. Il disposait de pouvoirs étendus et
ses décisions étaient rarement critiquées. Le consul était
désigné pour un an seulement.
Tous
les ans, à la Chandeleur (le 2 février), les chefs de famille
du village se réunissaient pour désigner leur "consul".
Celui qui avait le plus de voix était désigné, quelquefois
à son corps défendant. Mais il ne pouvait refuser. Il devait même
déposer une caution de 200 écus, restitués avec intérêt
à son départ, car il était responsable sur ses deniers
du recouvrement de l'impôt et de l'excédent des dépenses
sur le budget prévisionnel. Il disposait de pouvoirs étendus et
ses décisions étaient rarement critiquées. Le consul était
désigné pour un an seulement.
![]() Les
Briançonnais durent craindre que leur passage sous la couronne de France
ne les prive de leurs privilèges. Redoutant cette cession, ils profitent
qu'Humbert II est financièrement aux abois pour lui proposer d'acheter
leur affranchissement.
Les
Briançonnais durent craindre que leur passage sous la couronne de France
ne les prive de leurs privilèges. Redoutant cette cession, ils profitent
qu'Humbert II est financièrement aux abois pour lui proposer d'acheter
leur affranchissement.
![]() La
transaction fut signé à Beauvoir le 29 mai 1343, en présence
de nombreux dignitaires, comme l'évêque de Grenoble. Celui-ci est
établi en latin par le notaire Guigues Froment sur deux grandes peaux
de mouton réunies. Le Dauphin Humbert II accorda aux 18 représentants
des communautés du Briançonnais des avantages économiques
et fiscaux en échange de 12000 florins d'or et une rente annuelle de
4000 ducats. Ce document connu sous le nom de Grande Charte des Escartons est
toujours conservé à la mairie de Briançon. Les libertés
accordées furent confirmées par tous les rois de France jusqu'au
traité d'Utrecht.
La
transaction fut signé à Beauvoir le 29 mai 1343, en présence
de nombreux dignitaires, comme l'évêque de Grenoble. Celui-ci est
établi en latin par le notaire Guigues Froment sur deux grandes peaux
de mouton réunies. Le Dauphin Humbert II accorda aux 18 représentants
des communautés du Briançonnais des avantages économiques
et fiscaux en échange de 12000 florins d'or et une rente annuelle de
4000 ducats. Ce document connu sous le nom de Grande Charte des Escartons est
toujours conservé à la mairie de Briançon. Les libertés
accordées furent confirmées par tous les rois de France jusqu'au
traité d'Utrecht.
|
|
|
Lettres-patentes
du roi Louis XIV, de février 1644, ratifiant la Transaction du
29 mai 1343.
|
![]() Les
habitants de ces communautés eurent le titre de franc-bourgeois, statut
intermédiaire entre celui de la noblesse et de la roture. Ayant donc
obtenu tous ses droits féodaux au Dauphin, les Briançonnais se
retrouvèrent dans une situation politique et économique infiniment
supérieure à celle de tous leurs voisins.
Les
habitants de ces communautés eurent le titre de franc-bourgeois, statut
intermédiaire entre celui de la noblesse et de la roture. Ayant donc
obtenu tous ses droits féodaux au Dauphin, les Briançonnais se
retrouvèrent dans une situation politique et économique infiniment
supérieure à celle de tous leurs voisins.
![]() 0n
appelle Escarton la communauté des habitants d'un même territoire.
Il y en a cinq qui sont respectivement:
0n
appelle Escarton la communauté des habitants d'un même territoire.
Il y en a cinq qui sont respectivement:
- L'escarton de Briançon, groupant 12 communes, comprend le val de Clarée,
le val de Cervières, le val de Guisane, la haute Durance en amont de
L'Argentière-la-Bessée et du défilé de Pertuis Rostan
et la Vallouise.
- L'escarton du Queyras, groupant 7 communes.
- L'escarton de l'Oulx, groupant 21 communes.
- L'escarton de Valcluson, ou Pragelas, groupant 7 communes.
- L'escarton de Château-Dauphin, groupant 4 communes.
Soit un total de 51 communes formant un ensemble appelé "Le Grand
Escarton"
6 ans plus tard, en 1349 Humbert II, n'ayant pas de fils, céda le Dauphiné
au fils du roi de France. (cet acte est appelé "Transport du Dauphiné"
au royaume de France)
![]() La
transaction signe l'extinction sans conflit de la noblesse. Avant 1343, les
nobles, pratiquement dépourvus de pouvoir féodal, abusaient de
celui que leur conférait la position très recherchée d'officier
delphinal : viguier, bailli, etc. D'où des conflits fréquents
qui disparaissent. Des nobles quittent les escartons au cours des deux siècles
suivants après avoir réalisés leurs biens. Mais certains
reviendront. Tous ceux qui restent ou reviennent se mêlent sans plus de
façons à la bourgeoisie. En vertu de leur entregent et de leur
savoir, ils seront souvent élus consuls.
La
transaction signe l'extinction sans conflit de la noblesse. Avant 1343, les
nobles, pratiquement dépourvus de pouvoir féodal, abusaient de
celui que leur conférait la position très recherchée d'officier
delphinal : viguier, bailli, etc. D'où des conflits fréquents
qui disparaissent. Des nobles quittent les escartons au cours des deux siècles
suivants après avoir réalisés leurs biens. Mais certains
reviendront. Tous ceux qui restent ou reviennent se mêlent sans plus de
façons à la bourgeoisie. En vertu de leur entregent et de leur
savoir, ils seront souvent élus consuls.
![]() Ces
communautés édictaient leur propre règlements de police.
Elles élisaient des juges qui statuaient sur les contraventions en se
référant aux coutumes locales. Initialement, les juges étaient
renouvelés tous les ans, comme les consuls. Puis ils furent renouvelés
par moitié tous les deux ans afin que les anciens puissent initier les
nouveaux. Les tribunaux ont fonctionné jusqu'en 1790, malgré l'abolition
de toutes les justices municipales prononcée dès 1556 par une
ordonnance royale. Les jugements n'étaient pas homologués au nom
du Roi, mais il ne vint à l'esprit d'aucun Briançonnais de les
contester auprès de l'autorité royale.
Ces
communautés édictaient leur propre règlements de police.
Elles élisaient des juges qui statuaient sur les contraventions en se
référant aux coutumes locales. Initialement, les juges étaient
renouvelés tous les ans, comme les consuls. Puis ils furent renouvelés
par moitié tous les deux ans afin que les anciens puissent initier les
nouveaux. Les tribunaux ont fonctionné jusqu'en 1790, malgré l'abolition
de toutes les justices municipales prononcée dès 1556 par une
ordonnance royale. Les jugements n'étaient pas homologués au nom
du Roi, mais il ne vint à l'esprit d'aucun Briançonnais de les
contester auprès de l'autorité royale.
![]() Etant
tous "Hommes-libres-francs-bourgeois", les Briançonnais avaient
tous le droit de chasse et le droit de porter des armes.
Etant
tous "Hommes-libres-francs-bourgeois", les Briançonnais avaient
tous le droit de chasse et le droit de porter des armes.
![]() La
liberté engendra la prospérité. Il y avait trois grandes
foires franches, dont une internationale, qui attirait des marchands depuis
la Hollande, les cités italiennes et de l'État Pontifical d'Avignon.
Les escartons prenaient d'importantes mesures pour assurer la sûreté
des voyageurs. Alors que de nombreuses ordonnances royales interdisaient, avec
une extrême rigueur l'usage des monnaies étrangères, ces
montagnards tenaces ont obtenu durant plus de deux siècles une exception
à la règle générale. A cette époque la ville
de Briançon compta jusqu'au double d'habitants par rapport à Grenoble
et la précéda pour l'esprit d'entreprise.
La
liberté engendra la prospérité. Il y avait trois grandes
foires franches, dont une internationale, qui attirait des marchands depuis
la Hollande, les cités italiennes et de l'État Pontifical d'Avignon.
Les escartons prenaient d'importantes mesures pour assurer la sûreté
des voyageurs. Alors que de nombreuses ordonnances royales interdisaient, avec
une extrême rigueur l'usage des monnaies étrangères, ces
montagnards tenaces ont obtenu durant plus de deux siècles une exception
à la règle générale. A cette époque la ville
de Briançon compta jusqu'au double d'habitants par rapport à Grenoble
et la précéda pour l'esprit d'entreprise.
![]() L'enseignement
était prodigué à tous les enfants. Chaque municipalité
nommait ses instituteurs après examen ou concours fin septembre ou début
octobre. Ainsi l'article 17 d'un règlement de Briançon de 1624
disait : "Nul ne sera reçu en cette ville pour maître d'école,
qu'il n'ait été examiné par deux avocats et un bourgeois
commis par le conseil; comme aussi seront ses gages résolus en conseil".
Une plume d'oie indique l'aptitude à enseigner la lecture et l'écriture,
deux plumes l'arithmétique et les sciences naturelles, trois plumes le
latin en plus.
L'enseignement
était prodigué à tous les enfants. Chaque municipalité
nommait ses instituteurs après examen ou concours fin septembre ou début
octobre. Ainsi l'article 17 d'un règlement de Briançon de 1624
disait : "Nul ne sera reçu en cette ville pour maître d'école,
qu'il n'ait été examiné par deux avocats et un bourgeois
commis par le conseil; comme aussi seront ses gages résolus en conseil".
Une plume d'oie indique l'aptitude à enseigner la lecture et l'écriture,
deux plumes l'arithmétique et les sciences naturelles, trois plumes le
latin en plus.
![]() Chaque famille était
tenue de payer "l'écolage". Au chef-lieu, la classe avait lieu
dans la salle servant aux réunions du conseil. Dans les villages, elle
se faisait... dans une étable, à l'abri de la froidure.
Chaque famille était
tenue de payer "l'écolage". Au chef-lieu, la classe avait lieu
dans la salle servant aux réunions du conseil. Dans les villages, elle
se faisait... dans une étable, à l'abri de la froidure.
![]() L'instruction du peuple atteignait
dans le Briançonnais un niveau sans pareil pour l'époque; 35%
des femmes et 90% des hommes savaient lire. En 1713, sous Louis XIV, des envoyés
de la cour, qui pensaient avoir à faire à des paysans illettrés
signant d'une croix, furent ébahis de recueillir de belles signatures
accompagnées de commentaires.
L'instruction du peuple atteignait
dans le Briançonnais un niveau sans pareil pour l'époque; 35%
des femmes et 90% des hommes savaient lire. En 1713, sous Louis XIV, des envoyés
de la cour, qui pensaient avoir à faire à des paysans illettrés
signant d'une croix, furent ébahis de recueillir de belles signatures
accompagnées de commentaires.
| |
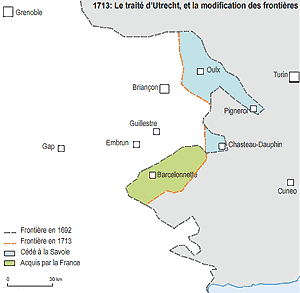 |
![]() Pendant
la Révolution française, le Briançonnais a été
touché de plein fouet par le vent des réformes. Le 14 juin 1788,
les Escartons sont conviés à participer à l'Assemblée
de Vizille du 21 juillet. Bien que les Briançonnais ne se sentent pas
concernés, l'Escarton Général décide d'envoyer des
délégués. Ils les sommèrent de s’employer
pour la défense des intérêts généraux, tout
en veillant soigneusement à la conservation de leurs privilèges.
Plus tard ils firent signer au secrétaire des Etats Généraux
les protestations contre les articles du règlement des trois ordres qui
portaient atteinte à leurs franchises. Ces protestations furent sans
effet. En mai 1790, les Briançonnais envoyèrent à l’Assemblée
Nationale une adresse d’adhésion au nouveau régime. C’était
la fin de la République des Escartons.
Pendant
la Révolution française, le Briançonnais a été
touché de plein fouet par le vent des réformes. Le 14 juin 1788,
les Escartons sont conviés à participer à l'Assemblée
de Vizille du 21 juillet. Bien que les Briançonnais ne se sentent pas
concernés, l'Escarton Général décide d'envoyer des
délégués. Ils les sommèrent de s’employer
pour la défense des intérêts généraux, tout
en veillant soigneusement à la conservation de leurs privilèges.
Plus tard ils firent signer au secrétaire des Etats Généraux
les protestations contre les articles du règlement des trois ordres qui
portaient atteinte à leurs franchises. Ces protestations furent sans
effet. En mai 1790, les Briançonnais envoyèrent à l’Assemblée
Nationale une adresse d’adhésion au nouveau régime. C’était
la fin de la République des Escartons.
Escarton d'Oulx
escarton-oulx.eu
La
rébublique de Briançon : pourquoi et comment?
jean.gallian.free.fr
Les
habitants des communautés briançonnaises au XIIIe siècle
www.persee.fr
La
« république des escartons », entre Briançonnais et
Piémont (1343-1789)
www.persee.fr